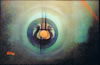|
Mademoiselle de Nervode, née d’une famille aisée, aurait eu, dit-on, une formation musicale, dans son enfance, avec Hullmandel puis Dussek et, en particulier, avec Viotti. Mariée très jeune, la marquise de Montgeroult se retrouve veuve en 1792. Pour la suite, les historiques divergent car la Biographie Universelle des Musiciens écrit qu’en raison de la Révolution « elle se rendit à Berlin, où elle publia, en 1796, une sonate de piano ; mais vers la fin du gouvernement du Directoire, elle obtint sa radiation de la liste des émigrés et revint à Paris » ; pour Michel Brenet (dans Quatre femmes musiciennes, articles extraits de l'Art 1894, 15 oct./15 nov., pp. 142-147) la compositrice demeure tout le temps dans la capitale et la musicologue ajoute, afin d’expliquer sa survie aux événements révolutionnaires, au choix, soit son mariage avec un journaliste influent, soit l’interprétation au clavecin, devant un tribunal présidé par Fouquier-Tinville, de variations sur la Marseillaise. S’il avait suffit de l’une de ses deux dernières hypothèses pour éviter la guillotine, gageons que plus d’un noble y aurait pensé et même quelques musiciens ! Quant à sa fuite en Allemagne, soi-disant attestée par l’opus 3, imprimé Outre-Rhin, on peut en douter car les premières œuvres mises sous presse - conservées à la Bibliothèque Nationale de France (département musique) - le sont toutes à Paris. Reste l’énigme essentielle jamais abordée. Comment cette aristocrate musicienne n’ayant jamais donné un concert public – au contraire de beaucoup d’autres femmes - a pu être nommée professeur au Conservatoire dès son inauguration ? Pourquoi a-t-elle pu être rétribuée au plus haut salaire à l’égal des hommes ? Certains affirmeront voir ici le résultat de sa production artistique, malheureusement une publicité de 1811 annonce la parution de ses 3 sonates… opus 5. Ceci signifie qu’auparavant elle avait peu écrit et, de manière certaine, n’entrait pas en rivalité avec des consœurs, mieux aguerries sur le plan musical, en 1795, lesquelles ne furent pas recrutées. Il faut donc en conclure que la valeur professionnelle n’a pas été l’élément essentiel des nominations et salaires. De fortes présomptions laissent penser son appartenance à ma franc-maçonnerie ; une partition, qu’une compositrice contemporaine lui a dédiée, permet de croire qu’elle y exerçait une fonction importante. Après trois années d’enseignement elle ne figure plus dans la liste professorale. La suite de sa vie n’atteste pas d’un brio musical particulier, ses Etudes, tardives, demeurent banales, par rapport à celles d’autres compositeurs, avec peu de modulations, et des formules stéréotypées. Le baron de Trémont va jusqu’à affirmer : « Elle composa sans savoir l'harmonie », mais se permettait de trouver chez Beethoven « de la divagation dans l’harmonie » … Elle décédera en 1836, à Florence. Issue de la lignée des Dumont, artistes peintres et sculpteurs renommés, a commencé ses études musicales tôt, avec de grands maîtres. Mariée très jeune à un flûtiste, le cas de cette musicienne, aux multiples facettes, mérite d’être approfondi. Après des séries de concerts de piano, souvent privés, et uniquement à Paris - dans le même temps d’autres femmes poursuivent une carrière européenne -, après la publication de mièvres de mièvres mélodies ; la première – sous une identité dissimulée – Le Berger fidèle, date de 1823. Seize années plus tard, elle fait encore paraître, sur un texte de M. Crevel de Charlemagne, une musique digne des paroles : : « Toi que j’appelle ma tourterelle, Tendre et fidèle, Vole vers moi »… Quant aux innombrables pièces avec variations sur des airs connus, et études, sans originalités, faisant pâle figure par rapport aux contemporaines. A trente-quatre ans seulement, elle aborde l’écriture d’un quintette, puis, juste avant son arrivée dans l’illustre Ecole, une symphonie, celle-ci au moment où certaines de ses consœurs créent des opéras… A-t-elle écrit seule les importantes et nombreuses partitions orchestrales suivantes ? Faits et analyse musicale semblent démontrer le contraire. Louise Farrenc est propulsée comme professeur au Conservatoire en 1842. Dans ma thèse de 3ème cycle (novembre 1973, Sorbonne) je faisais part de la découverte d’une lettre d’elle, adressée au Directeur de l’Ecole, lettre alors nouvellement remise aux Archives nationales :
J’ai immédiatement vérifié si la récrimination se trouvait fondée. Parmi tous les membres du personnel, madame Farrenc est la seule à avoir été admise comme enseignante, sans avoir aucun diplôme, et à toucher néanmoins 1000 francs ; les collègues cités n'enseignent pas la même matière qu'elle, d’où une comparaison ambiguë ; elle ose s’assimiler à Franchomme, compositeur et violoncelliste, ami et conseiller musical de Chopin au point de se voir dédicacer sa Sonate pour violoncelle. Quant à Narcisse Girard, il a du attendre encore une année après avoir obtenu le poste de chef d’orchestre de l’Opéra (1846) avant de pouvoir accéder à l’emploi que Louise Farrenc occupe depuis quatre ans ! Par ailleurs, partant de cette doléance, plusieurs biographes récents oublient de mentionner les nombreux enseignant(e)s, plus âgés, avec plus d'ancienneté et de références, n'ayant aucune rétribution. À titre de comparaison, Henry Duvernoy, né à Paris en 1820, avec cinq premiers prix du Conservatoire, nommé professeur adjoint de solfège en 1839 ne recevra un salaire de 600 francs qu’à partir de … 1850 ! Marmontel Antoine, né en 1816, avec quatre récompenses devient professeur adjoint de solfège en 1837 et ne sera salarié qu’en 1845 pour 300 francs, enfin, en 1850, il sera nommé professeur de piano avec des résultats pédagogiques bien supérieurs à sa consœur, mais avec le même salaire qu’elle. Madame Farrenc, peu préoccupée des faveurs de recrutement et financières dont elle jouit, fait preuve d’un égoïsme et d’un sans borne. Comment a-t-elle pu obtenir poste et salaire supérieurs à Hector Berlioz, Grand Prix de Rome ? Sa pédagogie se reflète dans les résultats de sa propre fille Victorine ; celle-ci ne décrochera, en tout au Conservatoire, qu’un premier prix de piano, bien tardivement par rapport à d’autres étudiantes. Autres questions.
|
|